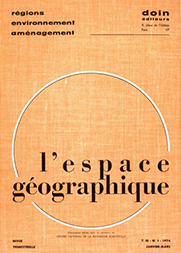
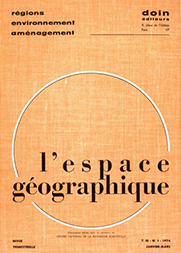
Limites et frontières
Claude Bataillon. Organisation administrative et régionalisation en pays sous-développés
Les réseaux administratifs des pays sous-développés, particulièrement instables, correspondent toujours à des systèmes importés, parfois par le colonisateur, réalisant des compromis avec les pouvoirs politiques locaux traditionnels et s’adaptant aux efforts d’intégration nationale des États du Tiers-Monde. Ces réseaux, le plus souvent d’origine espagnole, française ou anglaise, appliquent un même système à des populations très différentes (densités, mode d’organisation); les besoins des économies modernes leur superposent d’autres découpages plus vastes (commissions de bassins fluviaux, etc.). Le géographe étudiera particulièrement ces réseaux par rapport aux unités naturelles, aux densités de population, aux réseaux urbains; la monographie communale lui permet de repérer les élites locales et leurs capacités d’investissement. Des comparaisons sont fructueuses entre domaines coloniaux ou domaines culturels.
mots clés: ADMINISTRATION, RÉGION, TIERS-MONDE
Claude Raffestin. Éléments pour une problématique des régions frontalières
Le champ relationnel des sociétés est affecté par la frontière en tant qu’elle est susceptible de se déplacer, pourvue de fonctions et comme ligne de souveraineté juxtaposant des politiques différentes. Les effets de frontière peuvent être directs, indirects ou induits. Le cas de la région franco-genevoise en fournit, dans le domaine de la population, de l’économie et de l’organisation de l’espace, des illustrations spécifiques.
mots clés: (ORGANISATION DE L') ESPACE, FRANCE, FRONTIÈRES, SUISSE
Jean-Jacques Dubois. La forêt d’Eu. Un cas de permanence des frontières provinciales (2 fig.)
Dans le Bassin Parisien, plusieurs marches forestières attestent la permanence de certaines limites dans l’espace. Entre Picardie et Normandie, la forêt d’Eu est presque stabilisée depuis le XVIe siècle. Son maintien est moins dû aux conditions du milieu qu’aux structures foncières et à la position par rapport aux chefs-lieux des provinces, à Paris et à la mer. L’isolement contribue à expliquer l’économie originale et la survivance de ce «pays au bois», encore frontière au XIXe siècle.
mots clés: FORÊTS, FRANCE, FRONTIÈRES, MARCHES
Mesures de flux
Max Derruau. Les flux monétaires dans un village-centre du Bas-Languedoc: Capestang (15 tabl., 3 fig.)
À partir d’enquêtes sur le terrain, on a pu évaluer les productions, les revenus et les dépenses des agents économiques et des ménages d’un village viticole du Languedoc (Capestang, 3 000 habitants). L’analyse des flux monétaires montre l’importance des échanges internes, l’existence d’un très fort courant de transit (négoce des vins), la part essentielle du centre sous-régional le plus proche (Béziers, 35 % des flux), le faible rôle apparent des grandes villes.
mots clés: COMPTABILITÉ LOCALE, FLUX MONÉTAIRES, LANGUEDOC, VIGNOBLE
Michel Noël. Mobilité spatiale des industries, croissance et urbanisation (8 tabl., 8 fig.)
La mobilité spatiale des activités économiques est un élément essentiel de la dynamique d’un système économique. On l’a mesurée à l’aide d’un indice qui compare la variation des effectifs de chaque branche d’activité industrielle, dans chaque région française, à la variation totale. On aboutit ainsi à une double typologie qui met en évidence d’une part les vitesses différentielles du déplacement des activités industrielles dans l’espace selon leur nature, et d’autre part les vitesses différentielles dans la transformation de l’activité industrielle des régions. On observe des types distincts de liaisons entre la mobilité spatiale et la croissance des branches, les taux d’industrialisation et d’urbanisation, la croissance des villes, ainsi qu’un certain effet de rattrapage.
mots clés: CROISSANCE URBAINE, FRANCE, INDUSTRIES, LOCALISATIONS
André Thibault. Mobilité des hommes et organisations spatiales. L’exemple de la Picardie (8 tabl., 4 fig.)
La construction d’une géographie générale régionale impose une série de conditions expérimentales dont a retenu, ici, deux éléments: le principe, fonctionnel, de polarisation; le grand espace encadrant. Du premier se déduit la notion de système à trois éléments: noyau, espace entraîné, couronne rurale. L’espace encadrant représente le système d’ordre supérieur.
La Picardie a fourni le matériel d’expérience. Par l’intermédiaire de l’analyse des distributions et des arbres de classement, une série d’organisations plus probabilistes que déterminées apparaît, laissant entrevoir la formation d’espaces de vie quotidienne.
mots clés: MIGRATIONS, PICARDIE, VILLES (RÉSEAUX)
Position de recherche
Jacques Chevalier. Espace de vie ou espace vécu? L’ambiguïté et les fondements de la notion d’espace vécu
Revue: la cartographie
Sylvie Rimbert, Henri Vogt. Les orientations actuelles de la cartographie thématique
Lectures
L’espace géographique 4/73![]()
![]() L’espace géographique 2/74
L’espace géographique 2/74
dernière mise à jour: 11 février 2019